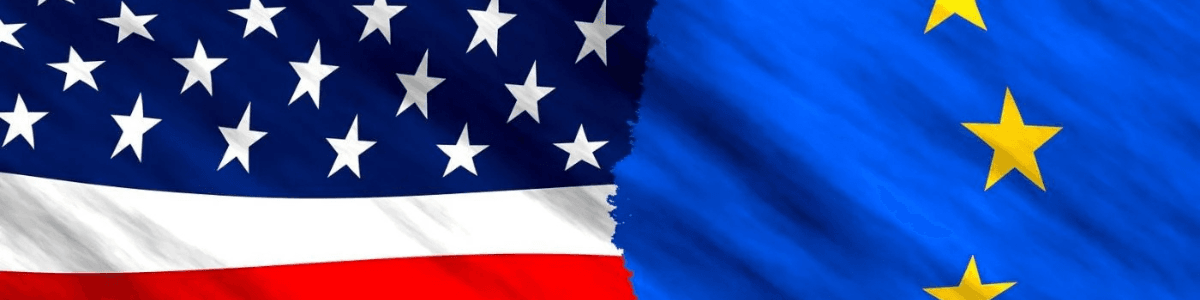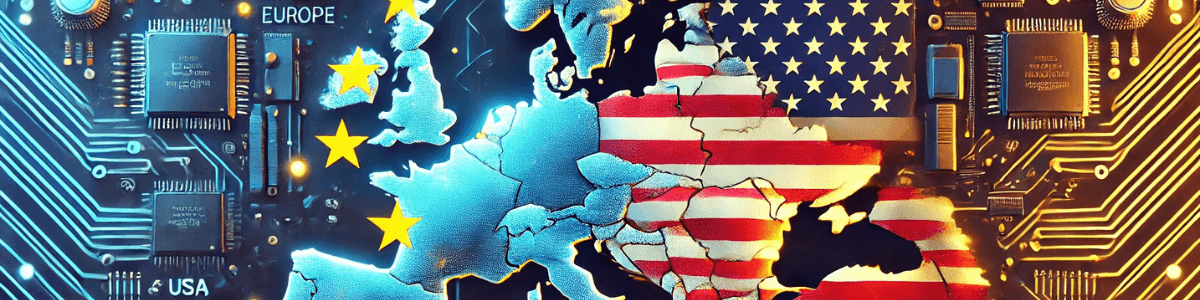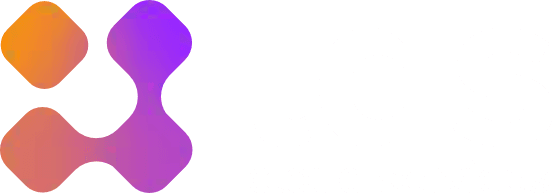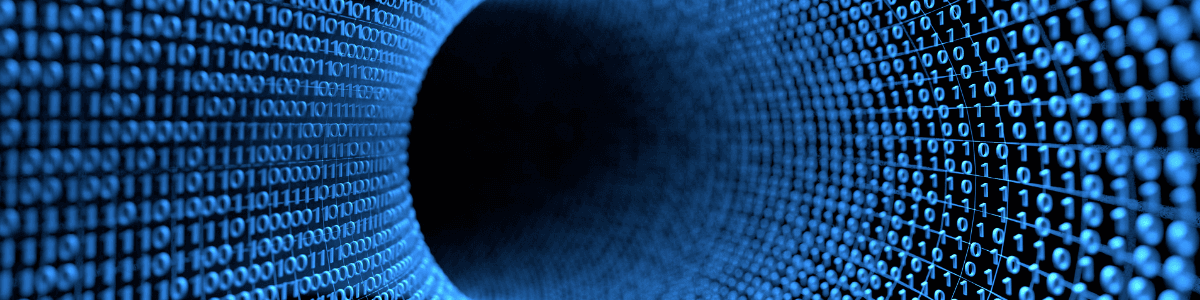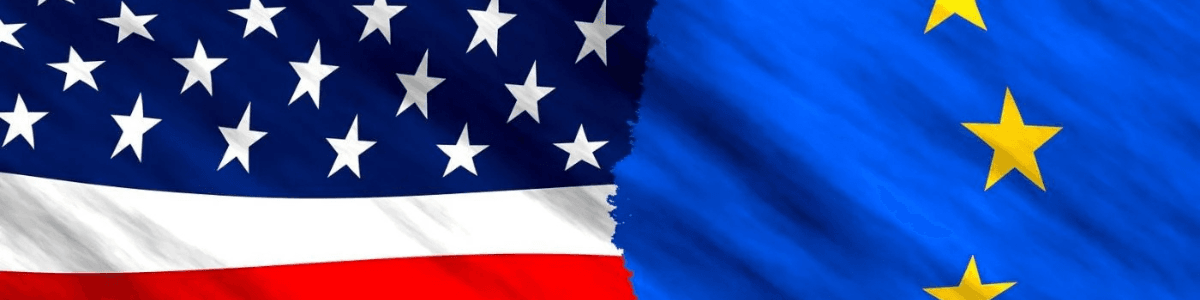Tout est dans le Cloud.
La question de la souveraineté des données revient sur le devant de la scène.
Pourquoi maintenant ? Parce que les premières décisions prises sous l’administration Trump viennent bousculer les règles du jeu qui encadrent les transferts UE - USA.
Quand on parle de transferts de données entre l’Union européenne et les États-Unis, on a souvent du mal à comprendre l’intérêt ou les problèmes qu’ils posent. Entre lois complexes, acronymes et accords internationaux, le sujet peut sembler technique et réservé. Mais pourtant, il impacte directement notre vie de tous les jours : nos emails, nos fichiers, nos appels vidéo, pro comme perso… Tout cela voyage à travers des serveurs situés souvent à des milliers de kilomètres.
Alors, pourquoi ne pas faire le point ?
Pas pour dramatiser ou pointer du doigt, mais pour mieux comprendre les règles du jeu.
Que se passe-t-il vraiment avec nos données quand elles franchissent l’Atlantique ?
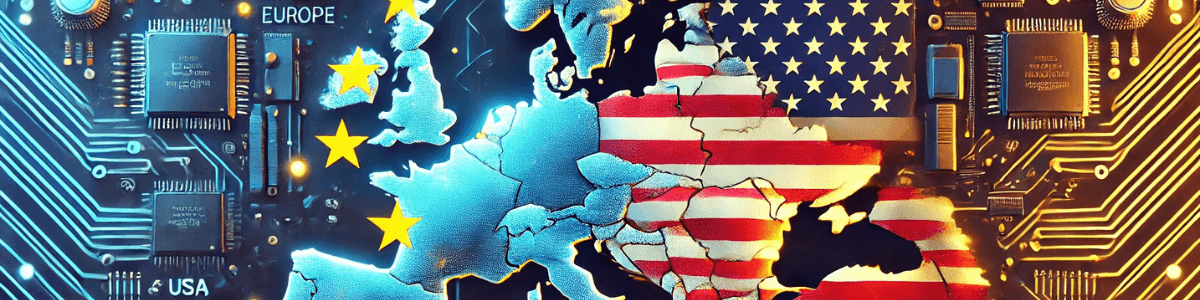
Comprendre le contexte actuel : une bataille d’équilibres
Si les données sont le nouveau pétrole, le cloud, lui, est l’autoroute qui les transporte. Et comme toute route internationale, il faut un code pour éviter les collisions. Ces règles, ce sont les accords entre l’Europe et les États-Unis, censés permettre à nos données de circuler tout en restant protégées.
Mais pour comprendre pourquoi ils font tant parler, il faut remonter à leurs différences fondamentales en matière de protection des données. Les deux continents ne jouent pas tout à fait sur le même terrain ni avec les mêmes règles.
(Accrochez vous avec les acronymes !)
Quand j'ecris ces lignes, on parle de la fragilisation de certains organismes de surveillance américains, comme le PCLOB (Privacy and Civil Liberties Oversight Board) qui joue un rôle dans le respect des accords comme le TADPF (Transatlantic Data Privacy Framework) (TADPF), qui avait été conçu pour garantir un équilibre entre les lois américaines et européennes.
Vous l’aurez deviné : entre les lois européennes (le RGPD) et les lois américaines (comme le Cloud Act), on ne parle pas tout à fait la même langue…
Petit rappel pour ceux du fond :
- Le RGPD, côté Europe : Un cadre ultra-strict qui protège nos données comme un coffre-fort. Pas de transfert sans garanties, pas d’accès sans raison valable.
- Le Cloud Act, côté États-Unis : Une loi qui donne aux autorités américaines le droit d’accéder à des données stockées chez des entreprises américaines, peu importe où elles sont dans le monde.
Bref, pour que ces deux approches cohabitent, plusieurs accords ont vu le jour au fil des années. : vous vous souvenez du fameux Privacy Shield ? Mais si, celui qui a été annulé en 2020, car trop laxiste.
Mais ne vous inquietez pas, pour combler ce vide immense, un nouvel accord a vu le jour : le Transatlantic Data Privacy Framework (TADPF). Son objectif ? Permettre aux données de circuler librement entre les deux continents, tout en respectant les exigences européennes. Mais vous l'aurez compris … cet accord repose sur des mécanismes fragiles.
L’un des rouages clés du TADPF, c’est le Privacy and Civil Liberties Oversight Board (PCLOB). Un organisme américain censé vérifier que les agences gouvernementales ne font pas un usage abusif de nos données. Mais voilà, sous l’administration Trump, cet organisme a été largement affaibli : les membres démocrates ont même été invités à démissionner, ce qui remet en question bien évidemment son fonctionnement mais surtout son indépendance.
Quand ce type de mécanisme vacille, c’est tout l’accord qui s’effondre avec lui.
Mais pas de panique : pour l’instant, le TADPF tient encore. La question, c’est… pour combien de temps ?
Et la vous me direz “Ok mais ca change quoi pour moi ?”
Et vous auriez tout à fait raison de vous poser la question ! Car en réalité, ca change tout.
Ces accords encadrent littéralement chaque email, chaque visio, chaque fichier partagé. Et si le cadre légal devient flou, ce sont les entreprises européennes qui devront s’adapter, et souvent dans l’urgence…. Bref, c’est bien plus qu’une histoire de lois : c’est une question de confiance.
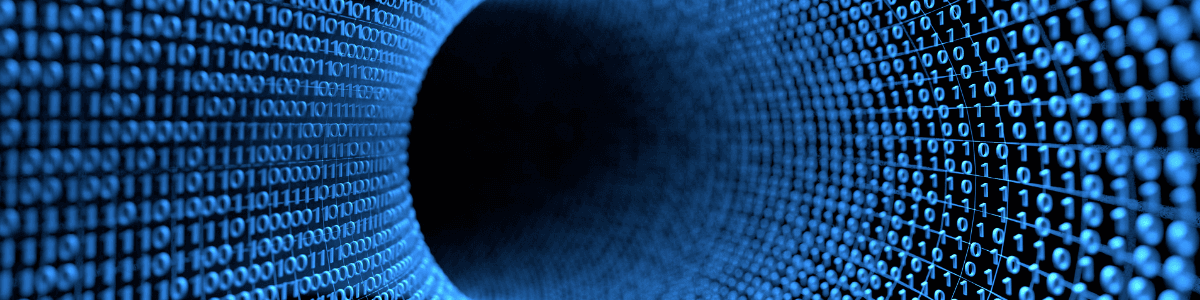
Pourquoi le TADPF est fragile ?
Très bonne question, merci de la poser !
Quand on parle du Transatlantic Data Privacy Framework (TADPF), c'est littéralement un château de cartes : solide en exterieur, mais reposant sur des fondations… discutables. Alors, pourquoi cet accord est-il si fragile ?
Eh bien, tout part d'une promesse. Ou plutôt, des promesses…
Il faut comprendre que pour que le TADPF fonctionne, l’Union européenne a accepté des garanties données par le gouvernement américain. Ces garanties incluent des mécanismes comme le PCLOB (voir plus haut). Mais voilà, ces protections ne reposent pas sur des lois adoptées par le Congrès américain, mais sur des Executive Orders et des engagements diplomatiques. En d’autres termes, ce sont des promesses signées par la Maison-Blanche.
Et les promesses n'engagent que ceux qui y croient.
Et c’est là que le bât blesse : ces promesses ne sont pas gravées dans le marbre. Comme l’a récemment montré l’administration Trump, elles peuvent être annulées d’un simple coup de stylo. D’ailleurs, Trump a déjà signé un décret demandant la révision de toutes les décisions de sécurité nationale prises sous Biden, y compris celles sur lesquelles repose … le TADPF. Et vous l'avez compris, si ces décisions tombent, l’accord s’effondrera avec.
On nous avait prévenu
Vous vous souvenez de Max Schrems ? Pour lui, le TADPF a toujours été "bâti sur du sable". l’Union européenne a préféré s’appuyer sur des garanties diplomatiques fragiles plutôt que d’exiger des lois solides et durables. Une approche qui avait été à l'époque très critiquée par de nombreux experts, qui craignent qu’un simple changement d’administration aux États-Unis ne suffise à tout renverser… Oh…
Et c’est exactement ce qui est en train de se passer. Si ces mécanismes continuent à vaciller, les transferts de données entre l’Europe et les États-Unis deviendront rapidement illégaux avec des conséquences pour les entreprises, les écoles, les administrations… Bref, pour nous tous.

Quid de nous ? Quid du vide juridique ?
Vous vous demandez peut-être : "OK, c’est bien beau tout ça, mais concrètement, ça change quoi pour moi ou mon entreprise ?"
La réponse est simple : beaucoup.
Parce que si le TADPF venait à s’effondrer, les transferts de données entre l’Europe et les Éats-Unis pourraient devenir illégaux du jour au lendemain. Et là, les conséquences … seraient immédiates.
Si vous utilisez une solution cloud américaine pour gérer vos emails, vos fichiers ou même vos outils RH, vous pourriez être contraint·e de cesser d’utiliser ces services, sous peine de ne plus être conforme au RGPD... Et soyons honnêtes : trouver une alternative, la déployer et former vos équipes, tout cela demande du temps mais surtout de l’argent.
La question de la confiance
Au-delà des aspects pratiques, il y a une question intéressante: celle de la confiance. Pour vos clients, savoir que leurs données sont protégées et respectées est devenu un critère clé. Si les entreprises européennes continuent de dépendre de solutions basées dans des zones juridiques incertaines, elles risquent de perdre cette confiance.
Alors, que faire ? C’est ici qu’un plan B prend tout son sens. Avoir une solution de repli, hébergée en Europe et conforme au RGPD, permet de limiter les risques et de garder une certaine sérénité. Ce n’est pas forcément une révolution, mais plutôt une approche pragmatique pour éviter de se retrouver dans une impasse.
Une opportunité pour reprendre le contrôle ?
Finalement, cette situation n’est peut-être pas qu’une source d’inquiétude. Oui, le Transatlantic Data Privacy Framework (TADPF) repose sur des bases fragiles, et oui, cela peut créer de l’incertitude pour les entreprises européennes. Mais c’est aussi l’occasion de repenser notre rapport aux données et de réfléchir à des solutions plus proches de nous.
Après tout, est-ce si étrange de vouloir savoir où sont stockées vos données ? Qui y a accès ? Et sous quelles lois elles sont protégées ? Choisir des solutions locales et souveraines, ce n’est pas rejeter la modernité. C’est simplement s’assurer que vos outils numériques répondent à vos besoins… sans compromis sur la sécurité ou la confiance.
Alors, est-ce que tout va s’effondrer demain ? Probablement pas.
Mais cette situation met en lumière un point essentiel : nous avons la possibilité de reprendre le contrôle. Et parfois, il suffit d’un petit pas pour faire une grande différence.